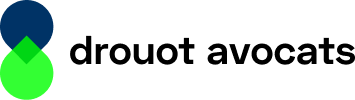Avocat pour la mise en œuvre de coopérations hospitalières
●Droit des sociétés et des affaires dans le domaine de la santé
●Structuration des établissements de santé
●Conseil auprès des professionnels de santé

Avocat pour une assistance à la mise en œuvre d’une coopération hospitalière
Vous êtes une clinique privée, et vous souhaitez mutualiser vos ressources matérielles ou développer un projet avec un établissement de santé public ? Nos avocats spécialisés dans la mise en œuvre de coopérations hospitalières offrent des solutions qui conviennent le mieux à vos besoins pour structurer et formaliser votre projet de partenariat.
Chez Drouot Avocats, nous proposons la création de structures juridiques spécifiques ou la rédaction de conventions adaptées pour mettre en place ces initiatives. Pour chaque intervention en région, nous analysons les enjeux en termes d’offre de soins sur le territoire. Pour cela, notre équipe s’attache à parcourir le Projet régional de Santé (PRS) et le Schéma régional d’organisation des soins (SROS).
Avocat pour la mise en œuvre d’une coopération hospitalière par la constitution d’une structure juridique
La mise en œuvre de coopérations hospitalières repose souvent sur la création de structures juridiques adaptées, comme le GCS, le GIE, le GIP, le GHT, ou encore le GCS-MS. Ces entités permettent d’organiser et de formaliser les relations entre les établissements et les professionnels concernés.
Groupement de coopération sanitaire (GCS)
Le GCS est une structure juridique mise en place pour permettre aux professionnels de santé, établissements de santé publics ou privés, établissements médico-sociaux, centres de santé et maisons de santé, de mutualiser des ressources ou de gérer des activités communes. Redéfini par la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST), qui a permis de clarifier le GCS de moyens et de le décliner sous la forme de GCS-Etablissement de santé, il vise à améliorer l’efficacité des services offerts aux patients en optimisant les moyens disponibles.
En effet, lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé.
La nature juridique d’un GCS dépend de sa composition : il peut être de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes de droit privé, ou de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé.
Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive.
Par obligation, un GCS doit inclure au moins un établissement de santé parmi ses membres.
Le GCS peut également inclure d’autres professionnels de santé ou organismes, sous réserve de l’approbation du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). La nature juridique du groupement détermine les règles budgétaires et comptables applicables à son fonctionnement.
Le GCS repose sur une convention constitutive qui précise son organisation et ses objectifs. Élaborée par ses membres, cette convention doit être validée par l’ARS. Le Groupement de coopération sanitaire peut être constitué avec ou sans capital social, mais ses statuts doivent obligatoirement prévoir la participation des membres aux charges de fonctionnement.
Le groupement a la possibilité d’employer des salariés, qu’ils soient médicaux ou non. Leur statut dépend de la nature juridique du GCS (public ou privé). Les membres peuvent aussi mettre à disposition leurs propres salariés, selon les règles applicables aux organismes à but non lucratif. En outre, le GCS peut bénéficier de personnels détachés pour accomplir ses missions.
En tant que personne morale autonome, il peut acquérir les biens et équipements nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Nos avocats spécialisés dans la mise en œuvre de coopérations hospitalières vous assistent dans la rédaction des statuts et l’organisation des règles de fonctionnement interne.
Groupement d’intérêt économique (GIE)
Doté de la personnalité morale de droit privé, le GIE est une autre option pour faciliter la mutualisation de moyens ou de services sans nécessiter la création d’un établissement de santé distinct. Créé par l’ordonnance du 23 septembre 1967, il permet à ses membres, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, de mutualiser des moyens pour développer leurs activités économiques tout en restant indépendants. Son cadre juridique est défini par les articles L.251-1 à L.251-3 du Code de commerce.
Le GIE a pour objectif d’accroître l’activité de ses membres, sans viser la réalisation de bénéfices pour lui-même. Il peut avoir un objet civil ou commercial, sans que ses membres deviennent commerçants pour autant. Il peut être créé avec ou sans capital, mais il doit compter au moins deux membres, qui sont solidairement responsables de ses dettes, comme dans une société en nom collectif (SNC).
Pour fonctionner, le GIE doit désigner plusieurs organes :
- des administrateurs (personnes physiques ou morales) ;
- un contrôleur de gestion (obligatoirement une personne physique) ;
- un contrôleur des comptes.
Lors de la création d’un GIE, il est essentiel de définir clairement le rôle de chaque membre dans le contrat constitutif, notamment en ce qui concerne l’administration et le contrôle. Les règles encadrant les fonctions de direction, comme les modalités de nomination, de révocation ou la durée des mandats, doivent être précisées. L’objet social doit être strictement lié à l’activité économique des membres.
Avec notre cabinet juridique expert en droit de la santé, bénéficiez d’un accompagnement sur la détermination des objectifs économiques et le partage des responsabilités juridiques entre membres. Nos avocats spécialisés dans la mise en œuvre de coopérations hospitalières interviennent dans la définition des organes de gouvernance, la mise en place des processus décisionnels et la résolution des conflits internes.
Groupement d’intérêt public (GIP)
Inspiré du GIE, le GIP est une structure juridique permettant des partenariats entre personnes publiques ou entre personnes publiques et privées. En tant que personne morale de droit public à statut particulier, il est régi par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n°2012-91. Le GIP peut être utilisé pour toute activité d’intérêt général à but non lucratif. Cependant, une collectivité territoriale ne peut pas créer un GIP, même si elle en a pris l’initiative.
Élaborée à partir d’un modèle proposé par le ministère de l’Économie, la convention constitutive du groupement doit être approuvée par l’autorité administrative compétente :
- le préfet pour les GIP locaux ;
- ou le ministre concerné pour les GIP nationaux.
Le cadre comptable du GIP dépend de son activité principale. Pour une mission de service public administratif, on applique les règles budgétaires et comptables publiques, conformément au décret n°2012-1246 sur la gestion publique. En revanche, pour des activités industrielles ou commerciales, le cadre juridique applicable à la comptabilité suit les règles du droit privé, offrant davantage de souplesse.
Le régime juridique des personnels du GIP varie aussi en fonction de son activité :
- droit public pour une mission de service public administratif, conformément au décret n°2013-292 ;
- droit privé pour des activités orientées vers le secteur marchand ou concurrentiel.
Notre équipe assure la rédaction de votre convention constitutive et sa publication au Journal officiel ou dans un bulletin officiel administratif spécifique, selon la portée géographique et sectorielle du GIP. Nos avocats spécialisés dans la mise en œuvre de coopérations hospitalières vous accompagnent dans l’obtention des autorisations nécessaires et la gestion des relations avec les autorités sanitaires.
Avocat pour mettre en œuvre une coopération hospitalière via la rédaction d’une convention sans constitution d’une structure ad’hoc
Certaines coopérations hospitalières ne nécessitent pas la création d’une structure juridique dédiée comme un GIE, un GIP, un GCS, un GHT ou un pôle de santé public-privé. Nos avocats spécialisés dans la mise en œuvre de coopérations hospitalières accompagnent les établissements sanitaires dans la rédaction de conventions adaptées pour formaliser des partenariats.
Conventions de co-utilisation pour un partage optimisé des ressources
Les conventions de co-utilisation permettent à plusieurs établissements de santé de partager des équipements ou des infrastructures. Ces accords de coopération répondent à des objectifs d’efficacité et de réduction des coûts tout en maximisant l’utilisation des ressources disponibles. Chaque établissement sanitaire signataire doit clairement connaître ses droits et obligations.
Par exemple, dans le cas du partage d’un plateau technique ou d’un appareil de radiologie, les modalités d’utilisation (plages horaires, entretien, remplacement en cas de panne) doivent être définies précisément. La répartition des coûts liés à l’entretien, au fonctionnement et à la maintenance des infrastructures ou équipements médicaux est essentielle.
Les conventions de coopération doivent aussi prévoir les modalités d’accès et d’utilisation afin d’éviter toute concurrence déloyale entre les établissements membres. De plus, leur rédaction est souvent précédée par des négociations entre les parties. Nos avocats en droit des sociétés dans le domaine de la santé interviennent pour faciliter ces discussions, identifier les points de blocage et proposer des solutions adaptées.